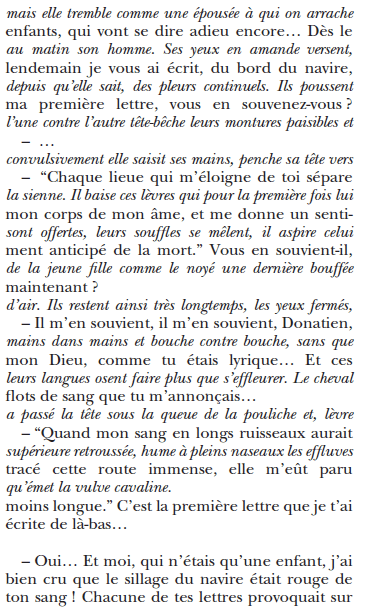C’est la chanson de Jean Ferrat au sujet de Robert Desnos et de sa mort en camp de concentration, Robert le Diable, chanson émouvante à pleurer, qui m’a amené à me souvenir d’une notice lue dans un livre d’histoire littéraire ; j’ai voulu en savoir plus, en allant voir aux sources. J’ai trouvé l’édition bilingue d’Élisabeth Gaucher, Robert le Diable, chez Champion, coll. Classiques, 2006.
C’est la chanson de Jean Ferrat au sujet de Robert Desnos et de sa mort en camp de concentration, Robert le Diable, chanson émouvante à pleurer, qui m’a amené à me souvenir d’une notice lue dans un livre d’histoire littéraire ; j’ai voulu en savoir plus, en allant voir aux sources. J’ai trouvé l’édition bilingue d’Élisabeth Gaucher, Robert le Diable, chez Champion, coll. Classiques, 2006.
Robert le Diable s’est avéré être l’oeuvre d’un clerc anglo-normand, anonyme, du début du XIIIème siècle, qui comme d’habitude a fondu une série de thèmes et de formes plus anciennes pour créer une oeuvre nouvelle, puissante, à valeur d’exemplum — et inscrire un nouveau mythe littéraire dans notre littérature. Le mythe littéraire, selon les mythologues, ne devient consacré et pérenne qu’à la condition de se greffer sur des thèmes anciens et puissants, peut-être ancrés dans la psyché humaine (ou au moins dans celle des participants de la culture où s’ente le mythe).
Tel est le cas de l’histoire de Robert le Diable, fils du Duc de Normandie (que plusieurs érudits ont voulu identifier à un personnage historique réel, sans qu’aucune solution ne fît consensus parmi les savants). Sa mère la Duchesse est restée 17 ans brehaigne après son mariage ; en vain a t-elle prié Dieu assidument. Furieuse, elle reproche à la divinité de ne pas répondre à ses prières : malheur au chrétien qui veut enchaîner Dieu, que ce soit par des prières ou des serments ! La duchesse en appelle au « Diable ailé » pour remédier à la stérilité de son union, puis s’effondre, et ne revient à ses sens qu’à l’entrée du Duc dans sa chambre ; elle est alors d’une beauté surnaturelle, et son époux n’y résiste pas :
« Dont eut li Dus si grant desir
Et tel talent d’a li gesir
Que, plus tost qu’il peut, sor le lit
L’emporte et en fait son delit (délice)«
Je ne traduis pas, pour ne pas offenser mes chastes lecteurs, et pour conserver les sonorités de cette langue de nos ancêtres. Mais on peut néanmoins se demander si le moyen-âge, à l’apogée de la courtoisie, avait une conscience élaborée du plaisir féminin… Je laisse la question aux spécialistes d’histoire sexuelle. Quoi qu’il en soit un fils naîtra de cette nuit de feu maligne, ce sera Robert. Tout enfant il tourmentera ses nourrices ; adolescent il frappera ses maîtres, au point qu’il sera impossible de lui enseigner à lire ou écrire ; adulte il attaquera et tuera les serviteurs de Dieu, et même les nobles amis de son père ; adoubé chevalier, au mépris de la loi chevaleresque il ne laissera pas vivant un seul de ses adversaires de tournoi. Le pape, alerté de ces ravages parmi son troupeau d’hommes, s’entremet et menace d’excommunication le Duc, s’il ne met fin aux désordres de son fils ; le Duc, faible et craignant que ne se retourne contre lui la violence de sa progéniture, préfère exiler Robert. Celui-ci part donc dans la forêt, accompagné d’une bande de brigands violents, et ses exactions ne font qu’empirer. Un horrible point d’orgue conclut cette première partie : Robert a connaissance d’un couvent peuplé de femmes de haute noblesse (et de haute beauté) qui ont choisi de se consacrer au Christ ; il y entre par la force, et à lui tout seul massacre tous les vivants qui s’y trouvaient, avec une prédilection pour le meurtre des nones les plus angéliquement belles. La scène qui s’ensuit a la précision de l’hallucination et la cruauté des visions auxquelles atteindront les surréalistes des siècles plus tard — les modernes amateurs de « gore » ne la renieraient pas non plus : Robert, couvert de sang au point d’en rougir entièrement la robe blanche de son cheval, entre dans la capitale de son père, tandis que les gens fuient et se calfeutrent devant ce retour démoniaque.
« Del fier et de la glaive toute
Est si sanglente qu’en degoute
Li sans a ses piés contreval ;
Et tous li chiés de son cheval
Est si chargiés trestout de sang
Que poy y pert partout de blanc. »
(Traduction Elisabeth Gaucher : « [la lame de son épée et toute sa lance] étaient recouvertes de sang, dont les gouttes tombaient à ses pieds ; même la tête de son cheval en était si imprégnée qu’on n’en distinguait presque plus la couleur. »)
Un étrange brouillard obscurcit la conscience de celui qui est l’objet unanime de la haine et de l’effroi… La grâce s’insinue dans l’obstination auparavant aveugle de l’insigne pécheur : « pourquoi moi » ? Il se rend auprès de sa mère, qui lui avoue le pacte diabolique auquel son désir d’enfant l’a conduite. Terrassé par la connaissance de son origine impure, Robert abandonne tout et se rend auprès du Pape, pour le supplier de l’absoudre… Le Souverain Pontife, dépassé par la démesure des fautes du misérable, le renvoie à un saint ermite, qui saura quelle pénitence lui infliger : l’épreuve, pour Robert, sera de ne plus parler, de passer pour un fou furieux, de ne se nourrir que des restes de la pitance donnée aux chiens. Robert gagne la cour Impériale (seul endroit où la populace n’ose le poursuivre pour l’écharper, puisqu’il doit jouer la démence) et y reste dix ans comme fou de l’Empereur ; cependant les Infidèles menacent Rome…
Il est inutile que j’en dise plus, et à vrai dire la narration dans sa seconde partie prend un tour plus attendu, et un peu répétitif (à tel point que je me suis interrogé sur la possibilité d’interpolations de copistes, mais Élisabeth Gaucher n’en fait pas mention). Inutile aussi que je commente la signification allégorique de l’histoire, dans le contexte religieux médiéval : ce n’est pas que je sois partisan d’une critique dés-historicisée, mais Élisabeth Gaucher dans sa préface évoque en spécialiste les significations médiévales de la folie, les considérations patristiques sur les accès du corps au monde et à la connaissance puis à la grâce, les valeurs illocutoires de la parole dans la pensée du moyen-âge… Je renvoie à son édition, et à sa bibliographie. Ce qui m’intéresse à titre personnel et pour faire connaître ce texte important de mon patrimoine, ce sont les échos, les répercussions qu’il éveille dans l’esprit du lecteur moderne. Car je crois à une signification de cette légende qui, si elle ne saurait être universelle et intemporelle, enjambe néanmoins les siècles, et demeure étonnante et presque perturbante, pour une conscience moderne. Il s’agit du mythe de l’origine, et de la part maudite, ou sacrée, en tout cas de la part de mystère initial : celle ou celui qui se penche en elle-même ou lui-même, qui remonte toujours plus vers l’amont de ce qui la ou le fait, des sources de son désir, s’expose au vertige d’une anamnèse et d’une analyse infinies. « Je ne peux pas ne pas vouloir ce que je veux », ainsi que le disait Schopenhauer. Nos canaux n’ont pas de fin, nos vaisseaux sanguins pompent un sang de provenance, en définitive, inconnue, notre psyché trempe dans un bain aux contours indistincts. Il s’agit du grand mystère du parlêtre, que rencontre métaphoriquement Robert, et auquel le moyen-âge assignait cette origine parfois divine, parfois démoniaque. La pulsion nous occupe, nous négocions continuellement avec elle, comme une puissance qui nous identifie, ou parfois nous est étrangère, lorsqu’elle ne ravage pas une vie de même manière que Robert dévaste le duché paternel. (Autres échos psychanalytiques ici, mais il revient à chacun de donner son sens au texte).
Une autre écho, enfin, de ce texte — et j’ai conscience de m’aventurer ici sur un terrain piégé, aventureux et subjectif — serait celui des recours extrêmes et des compromissions auxquelles peut conduire le désir d’enfant, envers et contre tout : procréations d’êtres sans pères, pari immense dont sera éventuellement redevable un autre que celle ou ceux qui l’ont pris, vocation d’un être futur et pourtant aimé, aux tourments de l’absence et de l’inconnaissable.
 Courtney Pasternak, Liberal. Belle photo. Qu’au moins ça serve. Les voitures alanguies au stop, tout le paysage détrempé. Maisons, vieux style anglais, cachet du quartier. Le brun s’impose, brique et feuilles mortes sur le sol. Enfant. Une feuille morte rebondit. Écureuil, volée de moineaux. Rebondit sur les côtes luisantes, rissolées, du tram (vérification ultérieure : « rissolées » est ici absurde, amalgame évident avec « ruisselant »). Rails tournent, disparaissent derrière un buisson. J’aimerais y disparaître aussi. Mais froid, dans le parc. Il faudrait que ce soit le passage vers un autre monde, plus chaud. Littérature médiévale. Sentier tentant, vers la droite, et un autre. Feuilles pendent lourdes, pluie. Haies de genêts, ou autres — devrais apprendre les noms, ai acheté le livre. Sommets agités par le vent, mais je descends ves les fourrés. (Oiseaux, aboiements. Été parc chasse à courre, ici. Duc anglais. Costumes rouges, cors.) Barrière brisée, mais après, une autre plus récente. Table de pique-nique. Jamais venu ici, où vont ces chemins ? Peut-être, la nuit, il s’y passe… Voilà ! Bon Dieu, qu’est-ce que ça a poussé ! Tropical ! Impressionnant ! Mais déjà mourant. Le ruisseau, merde, une vraie rivière aujourd’hui. Pieds dedans ! Eau d’égout ? (d’égoût ? dégoût ? étymologies différentes…) Les barres apparaissent, au sommet de la côte striée de racines. Comme petit, enfant, Bois de Boulogne : une si petite pente quand j’y suis retourné ! Barres, seul sommet luisant visible, comme un trophée ou un totem. Flemme. Vais quand même faire ces tractions. Me tirera de la grippe. Ipod, Jung. Des arbres déjà rouges à travers les trouées où l’on peut voir. Barres mouillées et froides, acier dégoutte d’eau. Mais pas suintant, métal. Vraiment triste en fait. Mamie avec chien, tous deux emmitoufflés. Couple chic. Un chipmunk court sur le vieux tronc abattu. Faune présente, discrète. Chipmunk, mot algonquin. Cavité, tous ces recoins, tous ces chemins qui partent, sous les buissons…. Faudrait ramper. Bizarre qu’avec tout ça on n’arrive pas à se cacher, on reste exposé. Type russe, un habitué. « I am depressed with weather ! », il me dit en roulant les r. « Everyone is », je lui réponds avec mes r français. Il s’échauffe au milieu du chemin. Parle de sa fille. Filles loin, on essaye de suivre ce qu’elles font, elles ne sauront jamais qu’on se préoccupait toujours d’elles. Ou bien on blablate pour se donner bonne conscience, comment savoir ?
Courtney Pasternak, Liberal. Belle photo. Qu’au moins ça serve. Les voitures alanguies au stop, tout le paysage détrempé. Maisons, vieux style anglais, cachet du quartier. Le brun s’impose, brique et feuilles mortes sur le sol. Enfant. Une feuille morte rebondit. Écureuil, volée de moineaux. Rebondit sur les côtes luisantes, rissolées, du tram (vérification ultérieure : « rissolées » est ici absurde, amalgame évident avec « ruisselant »). Rails tournent, disparaissent derrière un buisson. J’aimerais y disparaître aussi. Mais froid, dans le parc. Il faudrait que ce soit le passage vers un autre monde, plus chaud. Littérature médiévale. Sentier tentant, vers la droite, et un autre. Feuilles pendent lourdes, pluie. Haies de genêts, ou autres — devrais apprendre les noms, ai acheté le livre. Sommets agités par le vent, mais je descends ves les fourrés. (Oiseaux, aboiements. Été parc chasse à courre, ici. Duc anglais. Costumes rouges, cors.) Barrière brisée, mais après, une autre plus récente. Table de pique-nique. Jamais venu ici, où vont ces chemins ? Peut-être, la nuit, il s’y passe… Voilà ! Bon Dieu, qu’est-ce que ça a poussé ! Tropical ! Impressionnant ! Mais déjà mourant. Le ruisseau, merde, une vraie rivière aujourd’hui. Pieds dedans ! Eau d’égout ? (d’égoût ? dégoût ? étymologies différentes…) Les barres apparaissent, au sommet de la côte striée de racines. Comme petit, enfant, Bois de Boulogne : une si petite pente quand j’y suis retourné ! Barres, seul sommet luisant visible, comme un trophée ou un totem. Flemme. Vais quand même faire ces tractions. Me tirera de la grippe. Ipod, Jung. Des arbres déjà rouges à travers les trouées où l’on peut voir. Barres mouillées et froides, acier dégoutte d’eau. Mais pas suintant, métal. Vraiment triste en fait. Mamie avec chien, tous deux emmitoufflés. Couple chic. Un chipmunk court sur le vieux tronc abattu. Faune présente, discrète. Chipmunk, mot algonquin. Cavité, tous ces recoins, tous ces chemins qui partent, sous les buissons…. Faudrait ramper. Bizarre qu’avec tout ça on n’arrive pas à se cacher, on reste exposé. Type russe, un habitué. « I am depressed with weather ! », il me dit en roulant les r. « Everyone is », je lui réponds avec mes r français. Il s’échauffe au milieu du chemin. Parle de sa fille. Filles loin, on essaye de suivre ce qu’elles font, elles ne sauront jamais qu’on se préoccupait toujours d’elles. Ou bien on blablate pour se donner bonne conscience, comment savoir ?