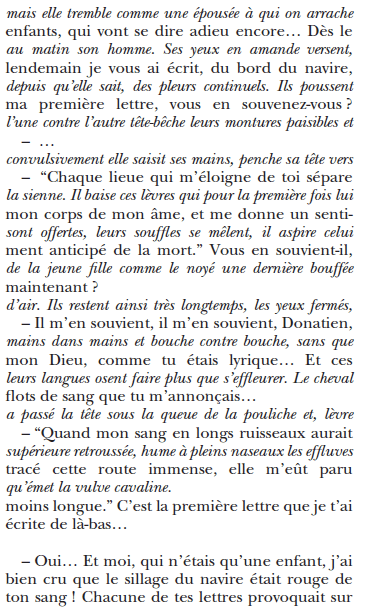C’est une expression que j’utilise faute de mieux, tant les options politiques américaines sont difficiles à décrire avec notre vocabulaire politique européen : le « libéralisme », qui est pour nous presque un synonyme de « capitalisme » et est associé à la droite, ne renvoie pas chez eux à l’économie mais à des choix moraux et sociaux associés à la gauche, etc… Il y a en particulier un individualisme américain viscéral, associé à une lyrique de la nature et des grands espaces, qui a peu d’équivalents sur le vieux continent. Discuter du cas de Jim Harrison pourrait permettre de comprendre un peu mieux ce que je crains être tout un pan de la sensibilité politique américaine, de Thoreau au Tea Party.
Je viens en effet d’achever de lire les Legends of the Fall, « Légendes de l’Automne / de la Chute », (lu dans l’édition Delacorte Press/Seymour Lawrence, 1978, pour les numéros de page), après deux autres romans, et je dois dire que ma lecture, d’abord passionnée, est devenue de plus en plus, disons, suspicieuse… Pour rendre avant tout justice au grand talent de Jim Harrison, j’évoquerai d’abord de ce qui entraîne chez le lecteur, moi ou d’autres, cette lecture assidue, qui ne vous laisse pas poser le livre avant que vous ne l’ayez fini : un puissant talent de conteur, qui enchaîne les histoires et les aventures sans répit, avec un impeccable sens du rythme ; un style parfaitement maîtrisé, à la fois classique et sobre, qui ménage ses surprises au détour des phrases, tout en s’effaçant pour servir le récit ; une aptitude à poser d’un coup de grandes fresques à l’échelle de deux ou trois générations ; des galeries de personnages excentriques, à la psychologie rudimentaire, ce qui fluidifie la lecture et personnellement ne me dérange pas puisque je ne supporte pas la psychologie en littérature (j’en reparlerai ailleurs) ; une aptitude à la suscitation des grands sentiments humains archaïques : perte, deuil, sens du temps, scandale de la mort des êtres aimés ; poésie de la nature et des saisons. (Quelques flottements dans la focalisation — le point de vue d’où le narrateur s’exprime — me surprennent un peu, mais d’une part il s’agit peut-être de ma formation française classique et cartésienne, d’autre part je sais par expérience qu’il est parfois difficile de ne pas faire d’accroc à la ligne que l’on s’est fixé.)
Tout cela n’est pas rien, et fait de Jim Harrison un grand écrivain, ce que je ne discute pas. C’est le filigrane politique (l’auteur réfuterait peut-être ce terme, mais je crois que nier faire de la politique est encore en faire), donc, qui m’est devenu déplaisant. Parlant d’abord de ce que faute de mieux j’ai appelé anarchisme (libertarianisme conviendrait peut-être mieux mais est peu usité en français). L’état, la nation sont loin dans les romans de Jim Harrison et lorsqu’ils interviennent, c’est en général sous les espèces de la bêtise et de l’oppression. Les deux niveaux politiques significatifs sont l’individu et le clan. (Ayant lu plus anciennement les autres romans, je puiserai principalement mes exemples dans Legends of the Fall)
En premier lieu, observons que les personnages principaux sont des hommes blancs et/ou « natives », ancrés dans la terre et dans un panthéisme ancestral, ainsi munis d’un savoir authentique que ne reconnaît pas la société moderne, en particulier de pouvoirs virils et guerriers au-delà du commun qui leur permettent de survivre à des épreuves surhumaines ou de donner la mort avec une infaillibilité tout aussi surhumaine.
Le clan est centré autour de l’un de ces personnages puissants, en général âgé et riche, centre dispensateur et animateur et chroniqueur d’une patriarchie. Les femmes du clan sont hystériques (femme de Ludlow dans Legends of the Fall), ou infidèles mais les hommes s’en fichent (femme de Ludlow), folles (première femme de Tristan puis d’Alfred), ou faibles (les deux précédentes) ou d’une beauté juvénile conventionnelle, mais dans ce cas le personnage est destiné à s’effacer du récit sans avoir pu développer de personnalité propre (seconde femme de Tristan). Le clan est associé à un territoire, le ranch du patriarche, moins consacré à des opérations productives qu’à un mode de vie naturel, où les hommes sont proches des bêtes, mais capables de les dominer à tout moment, en dressant des étalons sauvages ou en grattant amicalement le nez de redoutables taureaux. Pour justifier de la survie économique du ranch, il est fait mention de temps en temps de coups capitalistiques rondement menés, extrêmement rentables et en général à l’encontre des lois (trafic d’alcool durant la prohibition, contrebande avec le Canada). Les membres et les employés du clan ont d’ailleurs communément un passé criminel non spécifié (le meurtre est suggéré à chaque fois), mais que le patriarche couvre de son autorité et de sa compréhension, mentant aux autorités. La hiérarchie n’y est jamais stricte, et les chefs paternalisent de plain-pied avec les employés, au grand dam des éventuels représentants de l’ordre social extérieur.
Lorsque le clan est confronté à l’état et aux autorités, la solidarité joue automatiquement et sans considération morale. Ainsi un policier, membre du peloton qui par accident a causé la mort de la femme de Tristan, lors d’un contrôle routier, est-il abattu sans aucun sentiment par l’un des employés du ranch, après trois ans d’attente d’une occasion propice à l’embuscade (p.67). L’auteur ne s’attarde aucunement sur la mort de cet homme, qui n’a eu que le tort de travailler pour l’État, et d’être présent lors de l’accident fatal. L’un des deux personnages principaux, Tristan, fils et double du vieux patriarche, exprime plus de scandale à la page suivante lorsqu’un chasseur abat un grizzly endormi (p.70).
Ce double épisode du policier et du grizzly, tous deux abattus lâchement mais sans que la mort de l’homme provoque aucune réprobation (au contraire, elle est la juste expression d’une loi du talion spontanée et naturelle), alors que celle de l’animal est déplorée, fut l’élément qui m’a fait arrêter ma lecture, et réfléchir rétrospectivement à ce que j’étais en train d’avaler avec tant de plaisir de lecture. (J’ai aussi repensé à une interview d’un metteur-en-scène américain, qui rapportait que personne n’avait protesté contre l’assassinat d’un policier noir dans les premières images de son film, mais qu’il s’était fait abreuver d’injures pour la scène qui suivait, où un lapin était tué et dépiauté ! Je ne me souviens malheureusement pas de quel film il s’agissait.) Ce peu d’importance accordé à la mort des outsiders devient si outrancier qu’il est presque comique lorsqu’il est dit du patriarche Ludlow, après qu’il a tué au matin deux gangsters irlandais rivaux de son fils dans le trafic d’alcool : « In the stunned aftermath Ludlow collapsed but revived by dinner »… Il est sûr qu’une bonne journée de repos, et un bon dîner, pas besoin de plus pour vous remettre d’avoir fait exploser deux têtes au petit déjeuner ! Le contraste avec l’intensité émotionnelle liée aux morts du clan est presque la dualité structurante du récit.
Mais ce référent familial (ah ! la famiglia !) et patriarcal constant n’est que l’une des deux dimensions qui m’a fait proposer la qualification d’anarcho-maffiosisme. Car il ne faut pas oublier que la raison d’être d’une famille maffieuse, c’est de faire de l’argent. Or, dans le livre, un ordre plus vaste que celui du clan est bien respecté, consciemment ou inconsciemment, qui est celui du capitalisme. Dans une tradition littéraire anglo-saxonne remontant à Defoe, une grande attention est portée aux spéculations et aux commerces qui servent aux héros à établir leur fortune ou à la maintenir (malgré les traits de mépris envers les « riches » de la côte est, qui s’achètent des ranchs par caprice et ne savent pas chasser…) ; à cet égard la perspicacité capitalistique prodigieuse des héros fait écho à leurs connivence surhumaine avec les forces de vie et de mort. La grande dépression de 29 passe, occasion de quelques reventes juteuses de chevaux de race devenus rares, sans aucune évocation de la misère de masse. L’attention aux conditions de vie de la classe ouvrière est « sentimentalisme » dans ce monde de riches cow-boys oisifs : « Alfred [Alfred est le second fils du patriarche Ludlow] clearly understood the prerogatives of those who owned the capital while Ludlow who tended to doter was sentimental about miner’s wages and living conditions. When scab vigilantes hanged a Wobbly [un syndicaliste] from a bridge in Butte, Arthur [Arthur est le beau père d’Alfred] saluted them. » Le désespoir existentiel de Tristan, qui est finalement ce sur quoi la narration se resserre tout du long de ces Legends, ne semble pas atteindre son appétit d’enrichissement, tant il ne cesse d’enchaîner les trafics et les spéculations illégales incroyablement juteuses. Et Ludlow, malgré son « sentimentalisme » au sujet des conditions de vie des mineurs, durant la récession, bien informé, se contente de tirer son épingle du jeu en convertissant petit à petit et discrètement sa fortune en or, avant que les banques ne fassent faillite. Le fort prospère, les faibles sombrent, aucune notion de solidarité au delà du clan.
Pour être plus complet ce tableau moral des Légendes d’Automne doit aussi signaler que la métaphysique qui transparaît dans les œuvres de Jim Harrison semble être une sorte de vitalisme Schopenhauérien : cette philosophie est presque explicite p.44 de Legends of the Fall : la nature n’est qu’une émergence et une lutte de puissances aveugles, où les faibles périssent, où les forts survivent dans la douleur et le deuil, mais fidèles à leurs responsabilités. On pourrait évoquer Nietzsche et la volonté de puissance, si ne prévalait aussi un certain renoncement, plus proche des préconisations finales du Monde comme Volonté et comme Représentation : achetez-vous un ranch, cultivez votre jardin, ne vous préoccupez de la société. (Ce renoncement ne va pas cependant sans une grande emprise du bonze patriarcal sur son petit monde !) Cette philosophie des forces vitales et du lebensraum cow-boy, s’accompagne d’un romantisme hyperbolique de la nature — référence en dernier recours, et seule substance d’un monde amoral — qui est semblable à celle que l’on a trouvée avec étonnement dans le nazisme (paradoxe devenu classique du chef de camp de concentration ému par ses promenades dans le petit bois voisin). La vie n’a pas d’autre sens que l’accomplissement aveugle des forces vitales, la défense de la race ou, ici, du clan, et de son territoire. L’homme ne pèse pas : à qui n’appartient pas à la communauté la mort se donne sans une ligne de réflexion à son sujet (la mort des membres du clan étant par contre l’un des grands arc-boutants émotionnels du texte).
Mais je ne suis pas allé plus loin dans cette direction, et me suis refusé en définitive à voir dans ce texte du fascisme, car la dimension de totalitarisme étatique, essentielle au fascisme, est en contradiction violente avec les valeurs prévalant dans les œuvres de Jim Harrison. C’est pourquoi j’ai forgé cette catégorie ad-hoc : anarcho-maffiosisme.
Par ce petit tour d’horizon et de lecture, j’ai voulu essayer de caractériser les éléments d’une idéologie, qui m’a semblée de plus en plus puante au fur et à mesure de ma lecture. Pour conclure (ou pas), la question que je me pose — et j’ai failli en faire le titre de ce petit article — est alors : Faut il lire Jim Harrison ? Effet de l’âge peut-être, après n’avoir voulu considérer que les qualités littéraires chez les Chardonne, Céline, Drieu, Rebatet (évidemment plus faibles chez ce dernier, et ne contrebalançant plus l’aberration de son idéologie), la considération éthique a prévalu, et j’ai cessé de lire ceux qui soutiennent le meurtre. Néanmoins, comment oublier que Harrison m’a emporté et m’emporte encore dans ses grandes sagas aventureuses et familiales, et que certains inoubliables passages de shamanisme dans The Road Home m’ont ouvert des horizons entiers, nouveaux, qui m’inspirent maintenant pour mes propres écrits ? Je n’ai pas encore tranché, et peut-être le ferai-je à l’occasion d’une autre lecture de cet auteur — en attendant laquelle, je serai très intéressé à recevoir vos avis sur la question, et même vos réfutations et désaccords. Le débat est, de mon côté, ouvert.
D’un point de vue non littéraire, ces quelques réflexions nées de l’art de Jim Harrison pourraient servir à éclairer cette méfiance envers l’état, cet anarchisme recentré sur la famille et les proches, cet individualisme, que j’ai rencontrés chez des américains de droite comme de gauche, et nous aider à comprendre comment nos catégories de pensée européenne achoppent souvent à comprendre la réalité américaine.
Post-scriptum méthodologique :
Caveat 1 : Il ne s’agit pas ici d’analyse littéraire, mais en définitive morale
Caveat 2 : Cette analyse morale ne concerne pas l’auteur, mais l’immanence de l’œuvre. Ayant été moi-même confronté (à cause de mon roman Plantation Massa-Lanmaux) aux attaques idiotes qui résultent de la confusion entre l’homme-écrivant, l’écrivain (celui-ci, lui-même un personnage du roman), les personnages, je ne voudrais tomber dans la même naïveté et la même injustice. Qu’il soit donc dit que je ne juge nullement de qui est Jim Harrison dans la vie. J’essaye de discerner les valeurs pertinentes au monde littéraire qu’il crée. Après tout on se fiche du bonhomme — sauf à être invité à partager une fricassée de « elk » en son ranch du Montana — ce qui nous importe est d’approfondir, et de déterminer une position de lecture, vis a vis de l’œuvre.
Autres notes de lectures
Cliquer ici pour accéder à tous les articles de la catégorie accablements
Retour à la page d’accueil : cliquer n’importe où sur le titre du blog, La Bibliothèque des Sables.